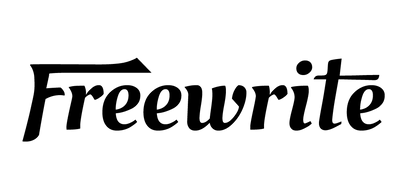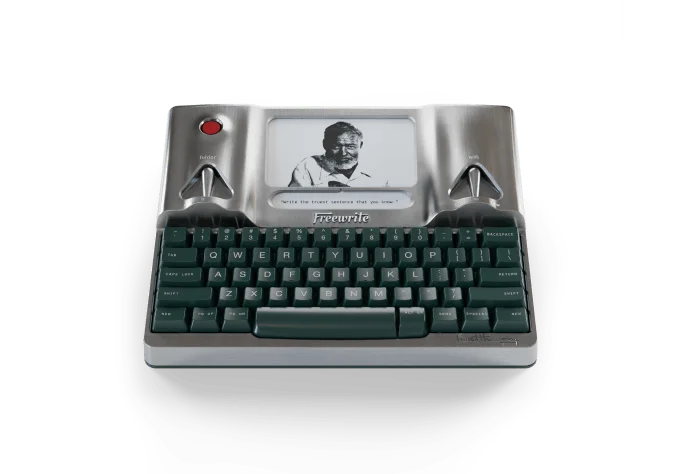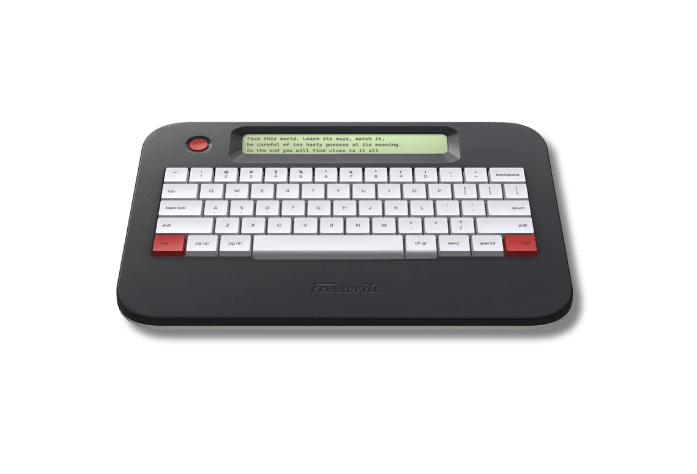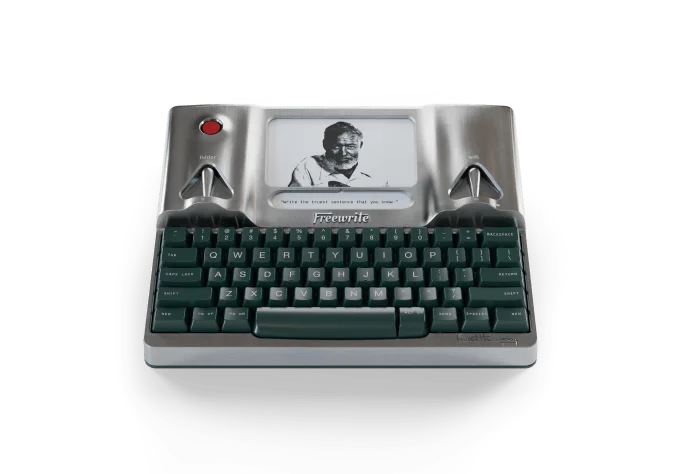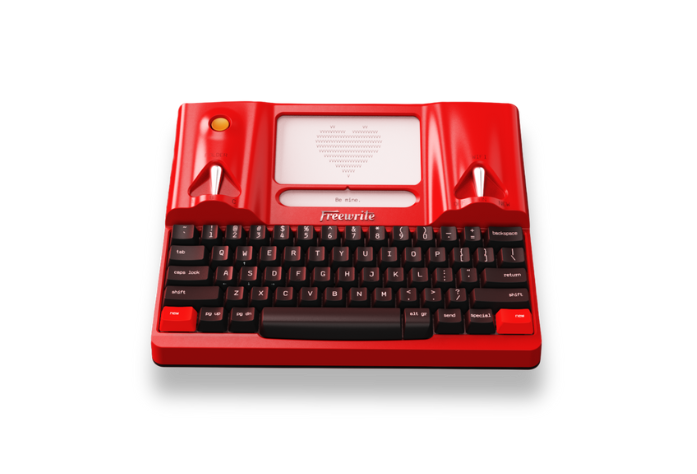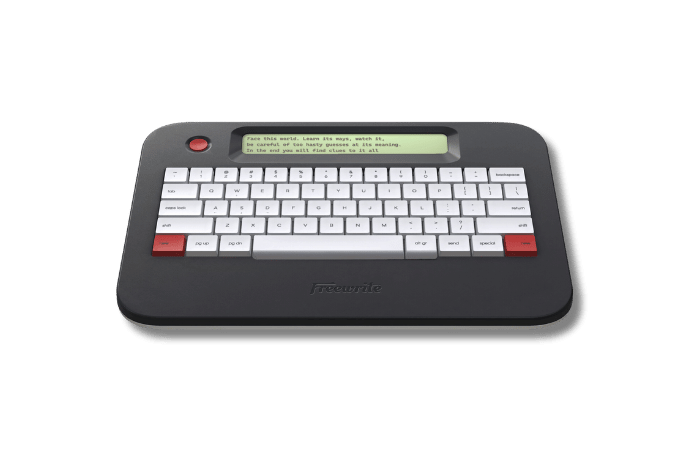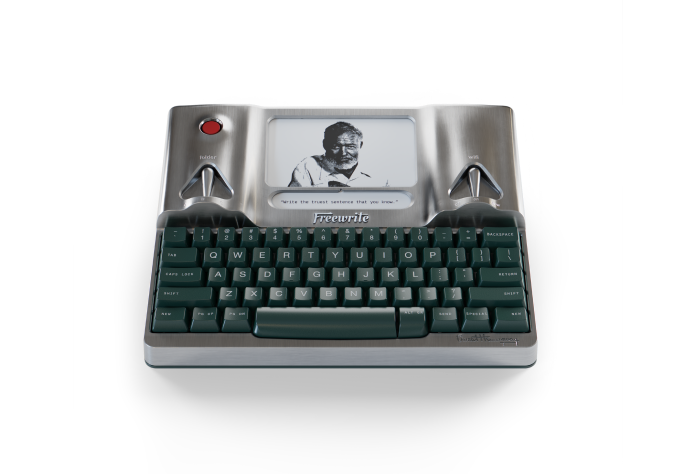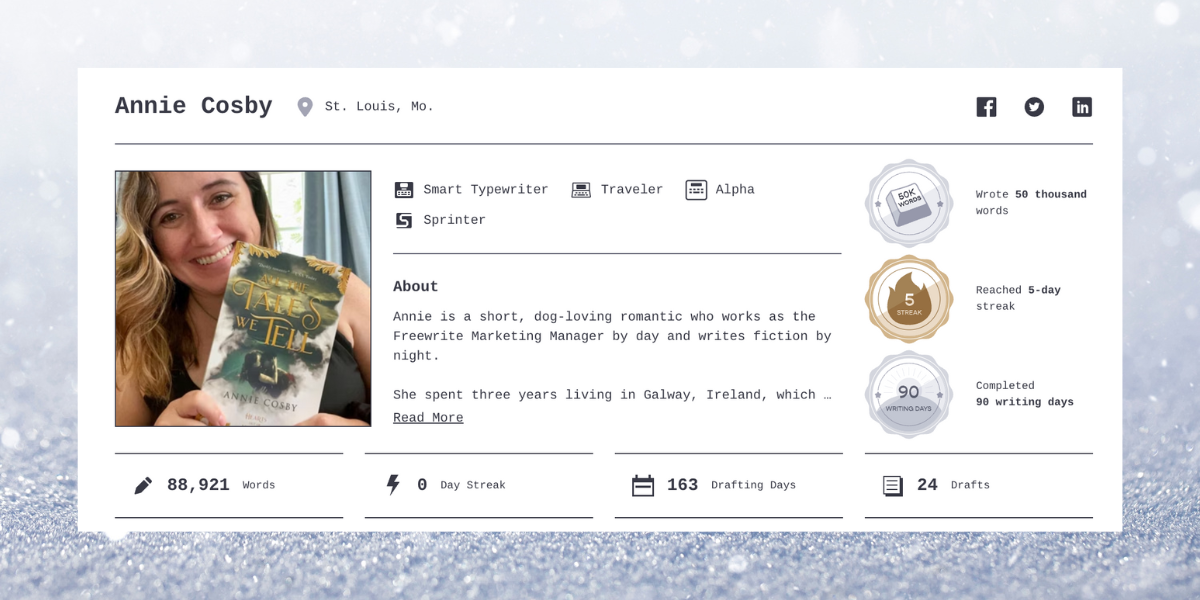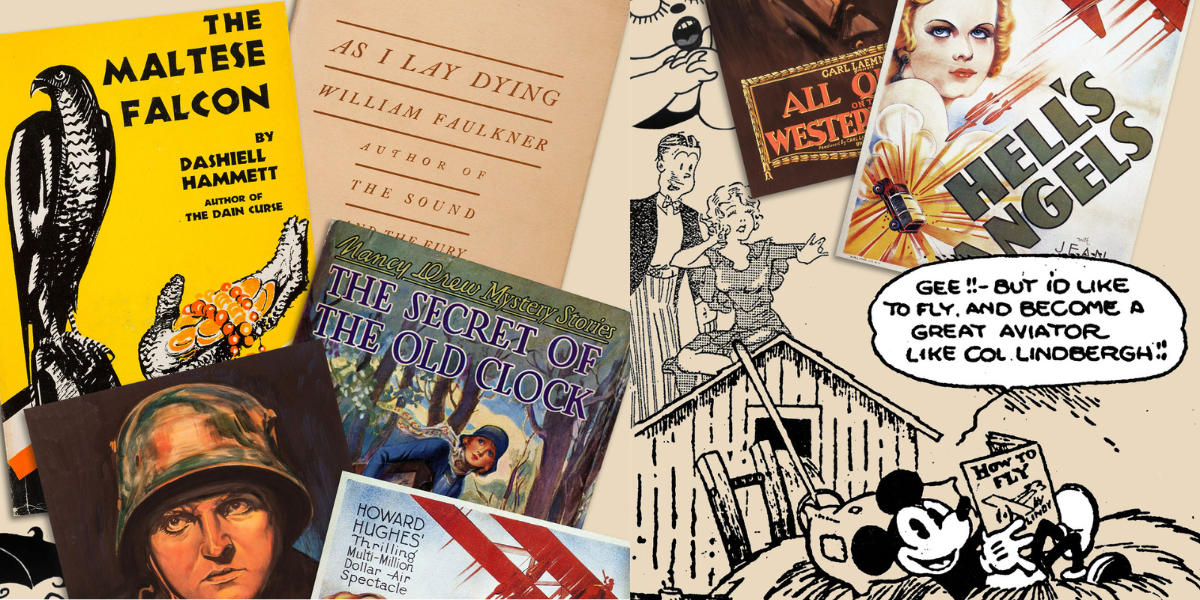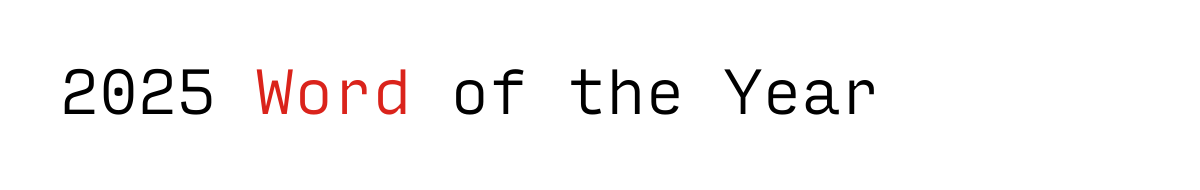De la littérature au cinéma en passant par la culture populaire, rien n'évoque Halloween comme la sorcière légendaire, et tout ce qui l'accompagne. Chats noirs, balais volants, potions, chaudrons, nez noueux et grimoires abondent.
Mais que se passe-t-il avec cette caricature ancienne ? Est-elle fondée sur la réalité ou n'est-ce qu'un ramassis de supercheries ?
L'histoire des sorcières est bien antérieure à Halloween, tout comme la tradition celtique dans laquelle cette fête moderne s'inscrit . D'est en ouest, du nord au sud, il serait difficile de trouver un document culturel qui ne possède pas sa propre tradition de sorcières.

La sorcellerie est ancienne
En fait, on retrouve des sorcières dans certains de nos premiers textes écrits.
L' Ancien Testament judéo-chrétien et même des tablettes d'argile mésopotamiennes plus anciennes font référence aux sorcières comme des figures concrètes de l'histoire humaine, et non comme de simples personnages de fiction. Ces anciens documents religieux servaient d'avertissements sur le pouvoir des sorcières et leur recours à une magie non autorisée pour provoquer des événements déplaisants.
Or, les sorcières n'étaient pas les seules à utiliser la magie dans ces ouvrages. Mais elles étaient spécifiquement pointées du doigt pour avoir utilisé un type de magie inapproprié, tout ce que les auteurs jugeaient inacceptable.
C'est un schéma qui se répète depuis des millénaires. Ce n'est pas la langue de triton ou l'orteil d'un mort qui donne un goût particulièrement désagréable à l'histoire des sorcières. Non, c'est simplement une panique morale pure et simple, et la recherche de boucs émissaires qui l'accompagne.
Ce n'est pas la langue de triton ou l'orteil d'un mort qui donne un goût particulièrement désagréable à l'histoire des sorcières. Non, c'est simplement une panique morale pure et simple, et la recherche de boucs émissaires qui l'accompagne.
Avant que nous en sachions beaucoup sur les microbes et la santé mentale, les phénomènes invisibles étaient expliqués par la magie et la religion. Qui pourrait nous en vouloir ? Dans l'Antiquité, la superstition et l'intuition étaient nos seuls arguments. Nous attribuions donc les événements positifs à nos divinités et à la magie positive, et les malheurs et les tragédies à des forces maléfiques, ou magie noire.
Qui pratique la magie noire ? Eh bien, peut-être le chaman aux croyances non conventionnelles sur la santé et la guérison. Ou peut-être la vieille sorcière effrontée qui défie les aînés de la tribu.
Pourquoi se contenter d'explications indépendantes de notre volonté quand on pourrait imputer le malheur à quelqu'un avec qui on a des problèmes ? L'histoire montre à maintes reprises que personne dans la société n'est aussi mûr pour un bon vieux pilori qu'une femme opiniâtre.
Les récoltes ont été mauvaises ? La vache est morte ? Le mari a eu une liaison avec la laitière ? Prenez vos fourches et votre plus grand bac à immersion : nous partons à la chasse aux sorcières.
L’histoire montre à maintes reprises qu’il n’existe personne dans la société qui soit aussi mûre pour un bon vieux pilori qu’une femme ayant des opinions bien arrêtées.
Quelques-unes de ses choses préférées
Bon, nous avons établi le contexte des sorcières : des boucs émissaires surnaturels aux origines magiques ancestrales, souvent victimes d'une misogynie enragée. Mais qu'en est-il de leur attirail occulte ?
Les sorts, potions et feux de joie avec le Diable sont logiques. Ils sont depuis longtemps associés à la magie noire.
Verrues, nez crochus et obsession de la jeunesse éternelle ? Inscrivez-vous au programme d'études de genre de votre université locale pour une introduction à la représentation des femmes dans les médias.
L'iconographie des balais et des chats, en revanche, appelle davantage de spéculations.
C'est ici que réalité et fiction se fondent dans le folklore. L'image d'un balai est-elle venue d'un chasseur de sorcières observant un rituel païen de récolte ? Ou s'agit-il simplement du fruit de l'imagination d'un aspirant démonologue, peu enclin aux tâches ménagères ? Quoi qu'il en soit, son créateur ignorait totalement l'impact que sa liberté créative allait avoir sur la culture populaire.
Cependant, tous les stéréotypes ne sont pas d'origine aussi douteuse. Il existe des approches scientifiques que l'on peut appliquer rétroactivement à des aberrations illogiques. Prenons l'exemple des liens entre les chats et les sorcières. Neil DeGrasse Tyson l'a expliqué succinctement dans un podcast récent : certaines femmes mystérieusement – hum, magiquement – insensibles à la peste se trouvaient être propriétaires de chats.
Les profanes de l'époque auraient pu crier « Sorcière ! » Mais nous savons aujourd'hui que les épidémies étaient transmises par les puces via les rats. Et s'il existe un moyen de débarrasser sa maison des rongeurs, c'est d'avoir un compagnon félin. Ajoutez à cela quelques siècles d'analphabétisme du Moyen Âge et une pincée de misogynie paranoïaque, et vous obtenez un stéréotype classique.
Alors, mélangez l'ignorance scientifique à la propagande alarmiste religieuse. Ajoutez à cela une haine profonde des femmes, et vous obtenez la potion infecte qui a conduit à notre caricature actuelle des sorcières.
Ajoutez à cela une haine profonde des femmes et vous obtenez la potion infecte qui a conduit à notre caricature actuelle des sorcières.
La bonne nouvelle ? À notre époque plus éclairée, des écrivains de tous bords se réapproprient l'histoire de la sorcière. De Broadway — pensez à Wicked — au grand écran — The VVitch de Robert Egger —, la sorcière souvent calomniée vit sa renaissance en tant que figure à la fois vénérée et respectueusement crainte.
De plus en plus souvent, nous explorons l’hystérie avec un regard critique sur les structures de pouvoir de l’époque… et nos réalités actuelles.
De plus en plus souvent, nous explorons l’hystérie avec un regard critique sur les structures de pouvoir de l’époque… et nos réalités actuelles.
Les sorcières ont encore aujourd’hui une emprise sur l’art et la littérature parce qu’elles nous renvoient nos peurs :
Notre manque de contrôle sur le chaos de l’univers ;
Nos faibles défenses contre la maladie et le malheur ;
Notre tendance à pointer du doigt, à accuser plutôt qu’à accepter.
Et c’est peut-être le rôle que jouent ces figures indélébiles dans notre histoire collective.
Ce qui est le plus effrayant chez une sorcière, ce n'est pas ce qui bouillonne dans son chaudron. C'est ce qui bouillonne et bouillonne dans nos âmes.